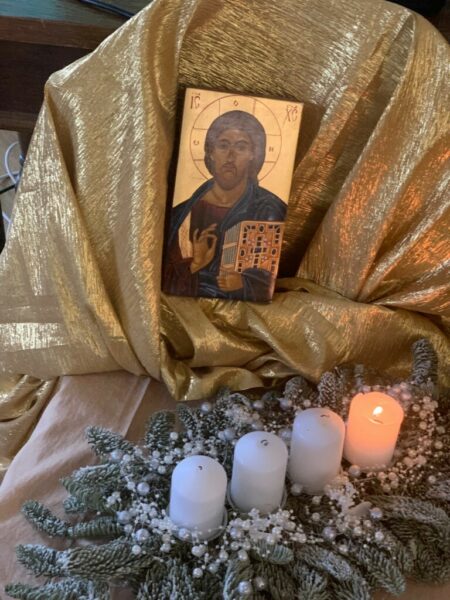7 décembre 2024 à Neuchâtel – « Un chemin fait de cheminS»
A l’image de Marie, une journée du temps de l’Avent pour s’émerveiller et s’ouvrir à l’inattendu de tous nos chemins
Par H. M.
Pierrot est assis devant sur le seuil de la porte de sa maison, ses camarades d’école passent devant lui et l’interpellent : Allez. bouge-toi, le chemin est long, nous arriverons en retard en classe ! Pierrot rétorque : la maîtresse nous a appris hier que la terre est ronde et qu’elle tourne sur elle-même.
Alors, plutôt que de me fatiguer à marcher, je vais attendre ici que l’école passe devant moi.
C’est ce que nous avons fait, par un samedi pluvieux de décembre, bien accueillis et installés à proximité de la collégiale de Neuchâtel juchée sur la colline. Après le moment de retrouvailles, avec café, thé, biscuits et quantité de bonnes et belles nourritures aux couleurs et saveurs de l’Avent, c’est assis sur nos chaises que nous avons vu défiler devant nos yeux et par la présentation de Véronique Tschanz Anderegg, tout un parcours sur le chemin des huguenots et des vaudois de la France au nord de l’Allemagne, en passant par la Suisse.
Bien plus qu’un chemin de mémoire du passé houleux de nos pays et des leurs anciennes guerres, nous avons vécu avec Véronique ce pèlerinage extérieur et intérieur, passant par routes et chemins parfois compliqués, découvrant paysages, animaux sauvages, fleurs et nuages, tout cela grâce au diaporama réalisé à partir des photos prises par Véronique pendant son voyage.
Après la pause repas, Marion Moser a pris le relais, car pasteure de l’église réformée elle aussi comme Véronique. elle a elle aussi rempli son sac à dos et est partie marcher, cette fois en sens inverse, du nord de l’Allemagne jusqu’en Suisse. Son expérience est relatée dans un livre publié en allemand, prochainement traduit en français « Mes pieds, mon sac à dos et moi ».
Autres chemins, autres expériences, aux auditeurs d’entendre et de ressentir, partager même, ces expériences de vie, faites de multiples difficultés, joies, émerveillements, récit de rencontres et d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. Nos deux voyageuses, après nous avoir montré sous forme de devinettes une série d’objet tirés de leur lourd sac à dos, ont répondu à nos nombreuses questions, auxquelles toutes deux ont répondu avec sensibilité, humour, émotion parfois. Questions pratiques, bien sûr, tant leur expérience tient de l’exploit, mais surtout questions sur le cheminement intérieur, la méditation et la prière, les rencontres, les changements pendant et après le voyage…
En fin d’après-midi, nous avons participé au culte animé par les trois pasteures et diacres présentes.
Après cette journée où nous avons largement échangé les uns avec les autres, médité, prié et chanté ensemble, nous repartons chacune et chacun de notre côté en remerciant les présentatrices, le groupe de Neuchâtel qui a tout organisé pour notre confort et pour permettre cette rencontre et pour que nous soyions remplis de reconnaissance et « rendant grâce pour la merveille de la vie humaine », comme si bien dit dans la prière finale de la WCCM.
Par Franck J.
En préparation à l’accueil de Celui dont nous célébrons la venue à Noël, cette journée de l’Avent était proposée par le groupe de Neuchâtel à la Collégiale sous l’intitulé « Un chemin fait de cheminS » – A l’image de Marie : une journée du temps de l’Avent pour s’émerveiller et s’ouvrir à l’inattendu de tous nos chemins, Véronique Tschanz Anderegg vous propose, avec la participation de Marion Moser, le récit d’une marche insolite, ponctuée de méditations, de partages et de belles rencontres.
Pour illustrer ce qu’il l’a amenée à s’engager dans le projet de partir à pieds sur un chemin de pèlerinage à la faveur d’un congé sabbatique, Véronique saisit une chaise pour illustrer le paradoxe de départ dans cet appel qu’elle a entendu : « assieds-toi et marche » … assieds-toi (pour ne pas te disperser) et marche (pour ne pas t’enfermer).
Par expérience, Véronique savait déjà que la marche montre des choses, révèle des émotions, ouvre des horizons, mais que son appel peut être entravé par des craintes, des préoccupations ; et c’est pourquoi Véronique pense que ce n’est pas elle qui a choisi le chemin mais que c’est le chemin qui l’a choisie puisque, au terme de réflexions diverses et de tergiversations qui dispersent, il lui est apparu comme une évidence de partir faire mémoire sur « les pas des huguenots. »
Sous cet intitulé, se déroule un itinéraire de randonnée long de 1 600 kilomètres qui relie le musée du protestantisme dauphinois de Poët-Laval, dans la Drôme, au musée huguenot allemand de Bad Karlshafen dans la Hesse, et qui s’appuie sur le chemin d’émigration de 250 000 Français protestants qui, suite à la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, ont pris la route pour fuir les persécutions et trouver refuge en Suisse et en Allemagne.
Véronique débute sur une vidéo-projection et présente d’abord le cadre de son expérience, fait de la riche histoire culturelle de cet itinéraire, en insistant sur les drames humains qui s’y sont déroulés (par exemple : une plaque commémorative d’un naufrage se trouve à Lyss où 111 huguenots trouvèrent la mort sur l’Aar le 5 septembre 1687), mais en soulignant aussi sa force de diffusion des progrès techniques et des idées (savoir-faire dans le textile, pratiques agriculturales).
Ensuite, nonobstant l’intérêt historique et mémoriel de ce chemin, Véronique s’est enthousiasmée pour la capacité de celui-ci à lui avoir permis de rencontrer des communautés actuelles et de s’ouvrir à l’inattendu, le chemin ayant été aussi le cadre d’une introspection qu’elle a tenté de nous restituer ainsi :
- Chemins de solitude : marchant seule mais restant une personne de contact facile, Véronique a pu faire la part des choses entre l’appétence à la solitude et une vie qui ne doit pas être solitaire, entre vie de famille, paroisse, responsabilités diverses.
- Chemins de prière : en forêt, dans des églises, devant des chapelles, sous la tente, la prière a été autant un accompagnement pour soi que l’expression pour quelque chose que l’on accompagne.
- Chemins de limites : tout en bordant la marche de manière continue, les limites physiques et psychiques constituent d’abord un espace de progression pour le corps et l’esprit.
- Chemins de beauté : derrière la beauté époustouflante des paysages, on délaisse aussi le laid aveuglement de la précipitation du quotidien en prenant ici le temps de regarder, de sentir, de saisir et de se laisser saisir …
- Chemins de réalité : il est apparu à Véronique combien il est important et facile de ne pas affronter ce qui nous est distant ou abscons (par exemple, en décidant de traverser les villes en bus plutôt qu’à pied coûte que coûte, façon de contourner sans scrupules le bruit et la fureur).
- Chemins d’émerveillement : plus encore que la beauté, certains moments font rencontrer le Nouveau qui vient à nous pour nous émerveiller sous différentes formes (et même dans le simple jeu d’un couple de cigognes perchées sur le nid au pied duquel la tente est plantée pour la nuit).
- Chemins de découverte : de son propre pays, et de lieux inconnus … parfois même proches de chez soi.
- Chemins de rencontres : avec des paroisses disséminées qui révèlent une force et une volonté extraordinaires de faire vivre les communautés locales, avec des hôtes qui accueillent généreusement, au bord du sentier (autres randonneurs ou pique-niqueurs d’un jour), avec soi-même (méditation, écoute de soi, importance de son propre corps et du respect qui lui est dû), avec le monde animal (les animaux sauvages de rencontre mais aussi les animaux domestiques dans les prés ou les fermes), avec l’exil vécu par des migrants.
Le retour à la maison – et à la „normale“ – est ce qui a été le plus délicat à gérer par Véronique ; qui s’est alors rendue compte que tout le monde est en chemin d’une manière ou d’une autre (méditation, chant, …), et que tous les chemins continuent car le pèlerinage, au fond, c’est la vie elle-même.
En introduction à la présentation de sa propre expérience, Marion Moser met l’éclairage sur l’importance de la vie spirituelle pour elle et, pour illustrer ce qu’il l’a amenée à rejoindre le Nord de l’Allemagne et marcher à partir de là durant 3 mois vers le Sud jusqu’à rejoindre la Suisse, utilise un gong qui, s’il est maintenu serré dans ses mains, ne peut pas vibrer au contact et ne résonne pas ; et qui a un besoin impératif d’espace et de temps pour exprimer ce pour quoi il est fait.
En effet, arrivée à un moment de sa vie dans lequel certaines choses l’horripilaient profondément sans en cerner – et encore moins en maîtriser – les causes et les conséquences, et parce qu’elle avait de plus en plus de mal à se „désénerver“, Marion a pensé prendre une année sabbatique et user de ce temps pour faire le point sur ses projets dans l’existence ; mais le vide n’étant pas de l’espace, elle a associé à la perspective de ce congé sabbatique une réflexion pour un séjour itinérant au Groenland, pourquoi pas vers le Pôle Nord, ou, plus classiquement, en randonnée dans le Salzkammergut.
Un collègue suggère alors à Marion de faire l’inverse et de laisser au vide l’espace nécessaire pour que quelque chose puisse s’exprimer à ce sujet et, face aux difficultés de Marion pour se déterminer sur un projet en particulier, lui affirme encore que si ses rêves l’ont lâchée, c’est qu’ils n’étaient pas assez grands !
Marion s’est alors engagée plus avant dans un mouvement consistant à jeter ce qui est inutile, à se libérer du superflu, à laisser en arrière ce qui est raté et qu’elle ne voulait plus garder en se sentant obligée d’y revenir plus tard pour le réparer.
Aussi a-t-elle démissionné de son emploi, mis fin au bail de l’appartement qu’elle louait, pris le temps de faire le tri et de jeter une partie de ses affaires, et choisi de partir du point le plus septentrional d’Allemagne pour se diriger ensuite à pied vers la Suisse (d’autres idées ayant été écartées car la période de son départ correspondant à l’épidémie de Covid, de nombreuses frontières étaient alors fermées).
Avant de laisser les auditeurs poser leurs questions, et pour rendre leurs récits plus concrets – et presque palpables, Véronique et Marion présentent des objets qui leur ont servi durant leurs périples : corde à linge utilisable sur tous supports, „sur-manches“ à tout faire (régulation de la température du corps sans avoir à sortir ou ranger un pull, protection lors de passages dans les ronces), cordelettes permettant dans une forte pente d’y attacher son sac à dos pour le laisser glisser devant soi en descendant sur les fesses, petits „gri-gris“ (collier, feuille de chants).
Un échange nourri s’installe ensuite entre les auditeurs et les conférencières, duquel il ressort les éléments suivants :
- Lorsque l’on „fait“ un tel chemin, c’est aussi le chemin qui vous fait : on va à l’essentiel (se lever, marcher, manger, dormir).
- Parce que cela se passe bien dès les premiers jours, on n’imagine plus que ça puisse mal se passer les jours suivants.
- Au retour, il est difficilement possible de conserver le rythme lent avec lequel on a vécu le chemin ; et d’éviter de sentir rapidement revenir peser sur soi toutes les charges mentales précédentes.
- Pourtant, des portes restent ouvertes : s’être sentie portée (par les prières des amis, par Dieu) ne s’oublie pas, même si d’autres portes se referment (par exemple pour Véronique : projet de changer de vie et devenir bergère qui ne se fera finalement pas, ou encore en coupant délibérément les ponts avec certaines personnes qui n’entrent plus dans les limites des valeurs du pèlerinage).
- Apprendre à vivre au quotidien les valeurs du pèlerinage permet cependant de prolonger durablement le chemin.
- Il y a différentes sortes de silence : le silence durant la marche n’est pas le même que le silence durant la méditation. Aussi, même s’il y a une réduction de facto des bruits extérieurs lorsque l’on marche dans la nature (où le silence n’existe pourtant jamais complètement puisqu’il y demeure toujours ne serait-ce que des bruissements), le silence intérieur peut être long à se faire (6 à 8 semaines pour Marion).
Enfin, Marion illustre avec une expérience vécue combien les plus grandes joies ne sont pas toujours celles auxquelles on s’attend : ainsi, parvenue au dernier sommet de son périple sans savoir encore quoi faire à son retour, elle est entrée dans un brouillard tel qu’elle était face à un „jour blanc“ (c’est-à-dire que l’on est comme face à un mur blanc devant soi, sans pouvoir distinguer ni l’horizon, ni même la limite entre le ciel et la terre à quelques mètres devant soi). Confrontée à l’impossibilité de suivre le sentier qui n’était plus visible, hormis pour les 2 pas devant soi, Marion a compris qu’il n’est pas besoin de voir le bout du chemin pour le suivre et qu’il est seulement nécessaire de faire les 2 pas suivants pour voir quels sont les 2 pas suivants à faire, et ainsi de suite pour avancer, puisque le chemin se découvre au fur et à mesure de la marche.
Cette métaphore m’a rappelé cet extrait de texte : « A vrai dire, il n’y a pas de but. On ne doit pas se fixer de but en dehors de soi-même. Chaque instant de cette vie doit être un but en soi. Réalisation de soi. Atteindre des sommets et à quelques moments isolés. Et puis continuer. Se dire avec confiance que le chemin mène quelque part, et ne pas vouloir à toute force apercevoir un but. » (Etty Hillesum – Les écrits d’Etty Hillesum – p. 248).
Cette belle journée d’échange et de partage a été rendue possible grâce à l’implication efficace et la chaleur de l’accueil du groupe WCCM de Neuchâtel (Monique, Fabienne, Danièle, Daniel, Claudia) que toutes et tous ont salué et remercié !
Photos: Fabienne R., Franck J., Claudia J.